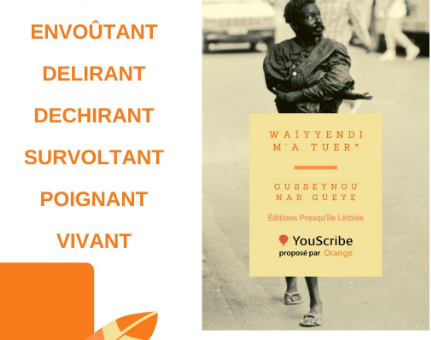Tract – Dans La Plaie de Malick Fall (1968), le héros, Magamou, traîne une vilaine blessure à la patte. Elle devient vite son identité, son fardeau, et curieusement, son atout pour exister dans la masse des anonymes. La plaie qu’il charrie, elle, se creuse, dégouline, pue. Elle fait de l’homme un pestiféré et un marginal. L’image même du fou que l’on tolère dans le sillage de la vie, avec un mélange de mépris, d’affliction, et d’affection. Il devient le véhicule des messages de l’auteur et l’oracle d’une vérité sociale fragmentaire. C’est à travers ce personnage que le mystérieux Malick Fall explore le Sénégal des années 60 : le rejet, la déshérence, l’errance, la ville, la frénésie, et au beau milieu de ce tourbillon, une dimension plus philosophique : une quête de sens. Si Magamou n’est pas explicitement diagnostiqué fou dans l’acception médicale, il en a les traits, les tares et les haillons. Magamou, ainsi campé, bien mis en scène par le romancier, tente d’incarner un symbole. Ultimement, il réussit à donner vie, forme, et voix, à l’intraduisible.
N’est-ce donc point cela finalement, la folie, que l’indicible ? Et, plus encore, cet amalgame de silence, de défaite, de désespoir, qui ne trouve plus que dans la déambulation, la métaphore d’une route sans destination ? Ousseynou Nar Gueye, dans son premier roman, fournit quelques éléments d’appréciation. Il reprend l’ouvrage de tricot de Malick Fall, et par la littérature qu’il taquine et salope à l’envi, sa force d’évocation, sa catharsis même, avec en plus la faconde personnelle de l’auteur. Waïyyendi m’a tuer* étend ainsi le domaine de la folie. Une extension qui donne à voir, ce que ce dérèglement, peut engendrer comme énergie littéraire, folie créative, folie sémantique, folie de la désarticulation. Une entreprise sciemment construite par l’auteur, mais comme avec tout enfant turbulent, elle lui échappe parfois, pour monter dans l’envolée comme dans la cacophonie.
Dans le livre, le héros-fou s’appelle Karbala. Il emprunte presque son nom à la ville chiite d’Iraq de Kerbala [terre de souffrance], symbole des batailles de succession dans la Oumma, et où convergent chaque année des fidèles lacérés de marques de sang. Et de bataille et de conflit, le livre en offre très rapidement. Du temps de sa superbe – même si le passage est plutôt elliptique dans le livre – Karbala avait son extension flamboyante, El-phénomèno. Garçon brillant, fraichement débarqué de bonnes études en « Toubabie », il conseillait alors un grand chanteur du pays (la Nittie), baptisé Waïyyendi. Ainsi parle-t-il de Waïyyendi : « la voix de Nittie dans le monde, celui que la jeunesse conquérante range parmi les symboles les plus aboutis de la réussite à la force du poignet, lui que les petites gens du pays comptent au rang des dépositaires chanceux de la baraka d’Allah, qui ne se trompe jamais dans la distribution hasardeuse de ses bienfaits » p.52. On notera dans la phonie de ce nom Waïyyendi, les clins d’œil à la langue wolof dans sa façon de désigner le chant, la chansonnette. On notera aussi la référence à l’idole nationale à travers ses initiales.
En bon ingénieur culturel, calé sur la question de la propriété intellectuelle, Karbala est le conseiller fétiche de son boss. Il a son oreille, mange à ses repas, jouit de sa confiance, côtoie sa cour, où fourmillent les appétits les plus empressés et les courtisans qui se bousculent. Mais un beau jour l’idylle prend fin. Si dès le départ, dans l’entourage du chanteur, Karbala détonne et dérange, le conflit qui éclate est lui tout à fait classique. Une affaire de gros sous, un chèque, déchire ce pacte d’alliance et de mésalliance. Ainsi s’ouvre le vertige de la désaffectation, qui finit en disgrâce, quand il est attaqué en justice. Dans ce grand labyrinthe d’épreuves, il a perdu force, éclat, mais bien plus précieux : son équilibre. Si la justice le blanchit en bout de course, la saveur de la victoire finale est ternie à jamais. Karbala n’est plus El-Phénomèno. Le roman narre l’avant, et cet itinéraire de la démence. Le mal a en effet déjà commencé son usure. Il a engendré un « fou ». Karbala grossit ainsi la cohorte des errants anonymes, personnages du décor urbain, reconnaissables, comme Magamou, à leur solitude. D’où viennent-ils ? Que fut leur passé ? A partir de quel moment est-on admis dans ce cercle ? La folie est-elle sociale ou clinique ? Waïyyendi m’a tuer* donne des réponses parcellaires mais riches. Des hypothèses sur l’origine de la folie plus sociale que médicale, dans une société où un déni persistant accompagne le manque de soin, pour ces individus livrés aux rares providences et aux vrais sévices de la rue.
Comment donc écrire tout cela aussi justement que possible, d’autant plus que l’histoire, fut une séquence réelle, vécue en tout point ou presque. Comment dépasser cet écueil majeur de la proximité du fait réel, et le transformer en énergie créatrice ? C’est bien là, dans la béance qui s’ouvre, que s’installe la possibilité de la littérature pour colmater, inventer, et essayer de guérir par le langage. Ousseynou Nar Gueye a donc trouvé son filon : raconter la folie, comme moyen et comme fin, habillée tout de même de la tunique de la farce et de la satire. Mais, surtout, la folie comme un écosystème général de refus des conventions, de l’établi, puisque justement, la norme est déplacée dans la marge. Le livre devient un élément de sa propre échelle. Avec la fausse naïveté inhérente à l’exercice, mais surtout, cet apparent délirium tremens foutraque donne sur une vertigineuse prose, qui met en scène l’injustice de la condition de Karbala et son attachement à la propriété intellectuelle, qui deviennent dans l’apparent chaos, les deux repères, si on doit trouver une ligne directrice au livre.
La folie devient l’accoucheuse d’une langue, d’une audace sémantique, d’un jeu. Géographiquement, on est en ainsi en pays de « Nittie ». La capitale devient « Kanddaru » où règne parfois, « Selaw-le-calme-plat » où on rencontre « Siiw-la-connaissance », ou encore, « Thiatt-la-langue-pointue » si ce n’est « Doff-l’humain-à-la-tête-retournée ». Toutes ces trouvailles, qui lorgnent du côté du conte national saveur Leuk-le-lièvre ou Yamb-l’abeille, avec un mélange savant de wolof et de français, donnent à voir l’empreinte linguistique du livre. Tout un langage qui enserre les éléments et les faits de cette cour de Waïyyendi, mais aussi, qui sublime l’amour, ressuscite la fidélité, conte la folie ordinaire, et orne la déambulation. Par leur foisonnement systématique et voulu, on se retrouve atteint de la même « néologite » qu’un Amadou Kourouma et ses incises du bambara. A côté de ce langage, de « ce troussage » de la langue annoncé en quatrième de couverture, on retrouve une obsession, voire une manie de l’auteur, avec jeu de mots, calembours, parfois faciles et qui viennent démembrer par moment la cohérence des trouvailles si entrainantes.
Le texte garde sa facture poétique. Les descriptions sont inspirées et entraînantes et le goût de la phrase spéciale chemine sans heurts avec une langue souvent riche et bien tenue : « Lahonassis avait la beauté ensauvagée, héritée de ses origines mauresques. Les yeux souriants, la bouche mutine qui se projetait en avant quand elle parlait- minaudait, le sourcil expressif. Le corps en amphore n’avait pas les attaches aussi déliées que celui de natives, mais n’en était pas moins une promesse de volupté. » p.26 Sans linéarité, roman à la chronologie cabossée voire déstructurée, on suit Karbala tantôt à la première personne, tantôt comme un acteur du récit, à la troisième personne. C’est à partir de ces points de vue narratifs variés que l’auteur raconte l’historique des relations qui mèneront à la disgrâce de Karbala. Il alterne avec les phases où Karbala décrit avec justesse l’errance, l’épisode judiciaire, la solitude. On y intercepte des poèmes, des sagesses de fabuliste dignes d’un Kocc Barma. Il s’échappe dans l’aphorisme, sonde le ventre de la réalité de son époque et s’autorise des embardées sur la vie politique, où chaque personnage est reconnaissable à travers son avatar romanesque. Ousseynou Nar Gueye a une belle écriture pour porter cet ensemble hétéroclite, qui désarçonne et décontenance le lecteur, tant l’expérience littéraire est inédite. Elle engage le lecteur car le livre ne se laisse pas lire, il se débat.
Tout au long du texte, Ousseynou Nar Gueye s’amuse. Mais il convoite les mots, leurs secours, bien plus encore, leur complicité pour dire, crier, réfléchir, pleurer, penser, sans se venger. Poussant même la magnanimité jusqu’à éprouver de l’amour pour son bourreau, comme une ultime expression du pardon. Le sentiment d’injustice, apte à nourrir la rancœur et son aigreur ressentimentale, est contenu. On est même en droit de se demander si Waïyyendi a vraiment tué Karbala ? Ne lui a-t-il pas donné, finalement, un bon de naissance, et un bon à tirer ce livre ? La question se pose. Le fou désigné est devenu par le truchement du roman le fou assumé, avec un renversement de stigmate. En cassant les codes de la folie, comme force inerte, passive, Ousseynou Nar Gueye en fait un instrument de conquête des territoires littéraires. Sans doute le lecteur, peu familier avec un tel univers, si singulier, se demandera d’où vient cette inspiration ? Comme jadis, se demandait-ton à Paris, d’où devenaient Les Chants de Maldoror, du comte de Lautréamont comme nous l’apprend Césaire. L’inspiration vient simplement, si on ose une réponse, de la tête d’un auteur qui s’émancipe des règles et foule au pied l’orthodoxie. Il tente un pari, et seule la lointaine postérité fera office d’arbitre.
Ousseynou Nar Gueye propose plus une satire, une fable, un conte philosophique, qu’un roman. Un hommage à la langue, à sa façon, par moment un essai sur le champ artistique et la question des droits, et la relégation des petites mains au profit des vedettes. Mais la force du texte d’Ousseynou se trouve, outre sa forme, dans le témoignage du point de vue de la folie, de la marche d’une société en quête d’une vérité introuvable. « Oui, là était peut-être la vérité ? Elle était dans la boule de feu, au centre de la terre des Nitts, cet enfer qui leur était promis et que l’on atteindrait si le Fou du Village continuait à excaver la terre d’argile périssable dont le Créateur s’était servi pour nous pétrir de ses mains, ce chaudron incandescent de feu perpétuel où Karbala avait prétendu pouvoir tous les précipiter, en les vouant aux gémonies. » p.95 Ousseynou Nar Gueye signe assurément le livre le plus culotté de la récente littérature sénégalaise. On lui en voudrait presque, de redevenir « normal », tant le salut semble passer par la folie.
Elgas, écrivain et journaliste
(Roman disponible sur Youscribe.com)